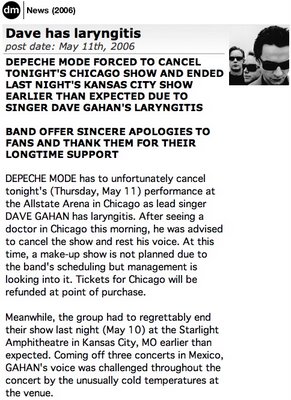— Tu rêves ?
— Ian ? Ne me dis pas que tu es déjà debout ?
— Penses-tu, on rentre.
— Tu veux du café ?
— … et toi, qu’est-ce que tu fais debout, à sept heures du matin ?
— Je… je prépare la journée, je suppose !
— Nadège, toujours à anticiper, à prévenir pour les autres ! Je veux bien un café.

L’excitation, la fatigue de la nuit ont tracé deux cercles beiges autour de ses yeux, accusé l’angle des pommettes. Sa peau est très pâle, plus blanche encore que lorsque j’en tombai amoureuse. Je n’ai plus aimé aucun visage pâle après Ian. Peut-être par fidélité à cet amour-là, peut-être parce qu’il y a quelque chose d’adolescent, de trop vert dans ces visages comme préservés de la vie. L’idée d’aimer une peau blanche aujourd’hui… me fait l’effet d’un désir presque incestueux. Il y a encore un an, à Berlin, Ian arborait son masque de punk mode : les cheveux rasés, le bouc, pratiquant assidûment la muscu et les U.V., c’était le clone de Pascal Obispo. « Mon » Ian s’était si bien éclipsé que c’est une surprise de le revoir aujourd’hui, blanc, imberbe, ayant laissé repousser ses cheveux, fidèle au lycéen de 85, jusqu’à la joue bleue du petit matin. Le surmenage, les abus n’ont fait qu’aiguiser ses traits les plus fins…
— Ian, tu as quelqu’un, en ce moment ?
— Non, oui… non, enfin… Toi ?
— Oh ! non…
— Tu ne vois plus jamais Dimitri ?
— Non. Tu sais, Dimitri doit avoir soixante-huit ans aujourd’hui.
— Tu l’aimais, ce gars.
— Oui… Il me plaisait, physiquement. J’aimais son odeur. Il avait une odeur très pure, et pourtant il picolait. Une odeur sucrée, douce… J’aimais bien nos moments ensemble, c’était sans lourdeur. Mais tu sais, il était grec, et marié…
— C’était un type gentil. Marrant aussi. C’est bien que tu l’aies eu. Sans lui tu aurais trouvé le temps long, dans ton île !
— Je ne me suis jamais ennuyée à Hydra. Et ça ne dépendait pas de Dimitri, de personne en fait.
— Oui, enfin… Une île grecque, même si c’est très beau on en a vite fait le tour. Je ne sais pas comment tu as fait pour y rester… cinq ans, c’est ça ? Et tu n’avais jamais envie de remonter ?
— Non. Je remontais quand j’étais obligée. Et puis l’été, à Noël… Mais qu’est-ce que tu imagines ? Que je regardais la mer avec l’idée de m’y noyer ? Bien sûr il n’y a rien à Hydra. Il n’y a rien si tu veux qu’il n’y ait rien… Moi j’avais tout. J’avais Pete. La mer était à nous, la lumière, à nous. Tout…
Il hoche la tête en signe d’approbation, boit son café à petites gorgées, allume une cigarette. Nous emportons notre tasse sur la terrasse où le soleil se lève.
— Mais… tu travaillais à l’époque ? Tu écrivais ?
— Bien sûr, enfin. J’ai écrit mon livre sur Leonard Cohen, tu sais bien.
— …
— Leonard Cohen, l’écrivain… le chanteur !
— Oui oui, je sais… Je me souviens. C’est pour ça que tu étais partie au départ, pour le rencontrer…
— Enfin Ian, atterris ! Non, il ne vivait plus là depuis au moins vingt ans. Mais l’idée, c’était de retrouver les lieux, le cadre de son inspiration… Philippe m’avait fait lire son livre,
Beautiful Losers. Il m’avait raconté son histoire avec sa femme, Marianne, et leur petit garçon. Leur vie incroyable, si libre et en même temps, si réglée… Ils économisaient l’eau, ils connaissaient chaque goutte d’eau… Tu m’écoutes ?
— Bien sûr, je t’écoute. Mais quand je suis venu, tu n’écrivais plus sur Cohen, tu travaillais sur ton roman.
— Oui, le premier. Au début, je devais rester trois mois, et puis l’article sur Cohen est devenu un livre, et puis…
— Je me rappelle très bien. Tu te levais tôt déjà, tu t’occupais de la maison, tu faisais la classe à Peter avant le déjeuner… Tu te mettais sur ton ordinateur à l’heure de sa sieste, tu tapais pendant deux heures, trois heures, sans bouger, c’était fascinant. Je n’ai jamais vu une telle facilité. Et tout ça en silence, comme une vraie abeille… Qu’est-ce que je faisais pendant ce temps-là ?
— Tu dormais, je crois ! Tu faisais la sieste avec Pete. Tu nageais aussi, beaucoup. Tu trouvais ça génial qu’il n’y ait pas de plage, pouvoir te baigner tout seul…
— Oui, c’est vrai…
— Tu étais tombé amoureux des rochers, tu disais qu’ils étaient la vérité.
— Non ? Ça, j’avais bien oublié !
— Sur le soir on montait au village…
— Oui, à pied… Ils n’autorisent toujours pas les voitures ?
— Je ne crois pas, non.
— C’était très beau, c’est vrai. Très pacifique. Je n’ai retrouvé ça nulle part.
— Tu ne buvais plus. Sauf l’ouzo de l’apéritif, mais ça… ce n’est pas boire…
— On a bien failli se remettre ensemble…
— On a failli…
Son regard parcourt l’horizon. Je l’accompagne. Par-delà la piscine, ouvert entre les hauts pins parasols, un profond espace s’étend. Une couleur de terre très claire semée de taches vert amande. Des champs, des fermes, des vignes… Cet espace ne prend pas vraiment fin : au loin les échancrures roses de l’Estérel s’étagent et fondent dans un voile blanc…
— Tu aimes ce pays, ici, je veux dire, ça doit te plaire, la nature, la lumière…
— Oui…
— Tu n’as plus besoin de vivre à Paris ?
— Pete… Le collège… Le journal…
— Oh, ton journal, tu donnes deux articles par mois ! Il y a Internet pour ça maintenant. Il y a des collèges dans le coin. Regarde Pete, lui aussi se plaît. Le soleil lui va bien, comme à tous les gosses. Comme à tout le monde… Tu as vu qu’il ose le short à présent ?
— Oui ! C’est énorme ! La dernière fois que je l’ai vu en short, c’était… il y a trois ans peut-être… c’était encore un petit garçon. Et regarde, il est déjà aussi grand que toi, non ?
— Pratiquement, j’ai l’impression.
— Il t’aime, tu sais. Il met tes chemises dans ton dos...
— Oh… il m’aime, et il me déteste, c’est normal.
— Oui… Qu’est-ce que tu voulais dire, avec ton histoire de collège dans le coin ?
— Oh, c’est juste… Quelque chose me dit qu’il ne va pas se passer longtemps avant que vous vous installiez par ici…

© Frédéric Le Roux, 2006
 Il nous regarde, Ian et moi, mimant de la main un geste, comme s’il agitait une clochette à hauteur de son épaule… Je reste un peu perplexe, c’est Bowie quand même, on n’a pas grandi dans la même cour. Il ne dit rien, répète son geste.
Il nous regarde, Ian et moi, mimant de la main un geste, comme s’il agitait une clochette à hauteur de son épaule… Je reste un peu perplexe, c’est Bowie quand même, on n’a pas grandi dans la même cour. Il ne dit rien, répète son geste.