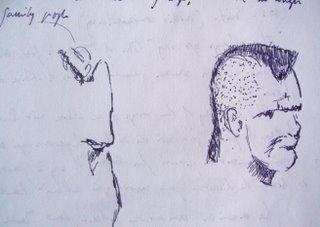Il fallait quand même qu’Andy croie en sa vocation, et peut-être, un peu, en moi, pour nous offrir une batterie à nous. Parce que c’est un matériel assez onéreux. Nos parents ont toujours encouragé notre activité musicale spontanée, ils nous ont aidés dans la mesure de leur moyens et dès treize, quatorze ans, Andy bossait après les cours pour acheter des instruments. Nous étions la boîte à musique du quartier, et on serait peut-être passés pour des martiens s’il n’y avait eu depuis toujours cette magie : Andy se mettant au piano ou à la guitare et commençant à chanter. Les gens s’arrêtaient devant la maison, ma mère laissait la porte ouverte et les voisins entraient discrètement pour l’écouter. Maman servait le thé et les biscuits, les
custard cream, les
lemon cream, certainement pas des
shortbreads ou des
ginger breads qui étaient beaucoup plus chers. De toute façon les gens ne venaient pas pour ses biscuits ou son Lipton. Andy chantait tout ce qu’on voulait et jouait sans partition, des airs traditionnels et religieux, les chants de Noël à Noël, des arias de Bach, de Pergolese ou d’Allegri. Surtout,
il inventait ce qu’il chantait, et c’était le plus miraculeux. L’un de nous, moi ou Gail, notre père parfois, prenait alors une flûte ou une guitare et l’impro devenait collective. Les inventions d’Andy nous inspiraient… L’accompagner, c’était comme déchiffrer une partition nouvelle à toute vitesse, mais le sens mélodique était tellement évident chez lui que ce n’était pas difficile, on devinait la direction qu’il prenait d’une mesure à l’autre. Maman disait toujours, en se rengorgeant, « ces enfants sont tous nés plus doués les uns que les autres. Et tous plus intelligents que vous et moi. Mais mon cadet, comme vous voyez, c’est notre Mozart… » Sa voix n’a mué qu’assez tard – fin d’une époque…

Fin 84 il y avait, dans la maison de Cleveland Street, un piano droit sur lequel tous les enfants jouaient, deux guitares acoustiques, une guitare électrique Epiphone (propriété exclusive d’Andy), une très bonne basse que j’avais achetée pour pas cher à des branleurs d’Oxford qui n’y connaissaient rien, une flûte traversière héritée du grand-père maternel et dont Gail jouait de temps en temps, cinq flûtes à bec (trois sopranos et deux ténors), un tambourin plutôt décoratif, et une superbe batterie Yamaha
rouge… Cette batterie fut d’abord installée dans ma chambre, puis dans la « buanderie » de maman, au sous-sol, d’où on l’entendait un peu moins. Nous ressortions gluants des séances dans cette pièce simplement cimentée, avec une toute petite fenêtre, où pendait quotidiennement le linge d’une famille de cinq auquel s’ajoutait une fois par semaine celui des Quine, nos voisins parkinsoniens dont maman se chargeait de faire la lessive. Finalement, la batterie trouva place chez Jonathan à qui ses parents « louaient » une dépendance dans leur jardin, moyennant l’entretien dudit jardin qu’ils n’avaient pas le temps d’assurer.
Mille six cents mètres carrés quand même. Vingt-trois pommiers, soixante-seize rosiers, trois glycines courant sur vingt-huit mètres de mur, quatre abricotiers, deux cerisiers et cent-soixante espèces de fleurs différentes, en massifs, en bordures, vivaces, bulbes, rhizomes… Jon était très rigoureux sur cette question de l’entretien auquel nous nous mettions dès huit heures du matin, le samedi et le dimanche. Andy et Ian débarquaient rarement avant dix ou onze heures, et il fallait littéralement les sortir de la cuisine, leur enlever la clope du bec et leur mettre la tondeuse ou le sécateur entre les mains. Mais ils étaient tellement lents, tellement maladroits qu’on les renvoyait généralement à la cuisine vers une heure pour préparer des sandwiches, et quand on avait mangé, on savait qu’ils n’y tenaient plus, on les laissait s’enfermer dans la remise où on les rejoignait vers trois-quatre heures. On répétait alors jusqu’à minuit, une heure, deux heures… Les réveils du lundi matin étaient mortels.

On commence à faire écouter les maquettes aux copains. On organise de petits bœufs chez Jonathan. On ne se prend pas encore la tête, ou du moins ça ne se sent pas trop. Ça reste encore une manière de s’amuser, de faire venir des filles… Shelley MacGovern, copine de boulot d’Andy, est une grosse attraction pour les mecs du quartier. Shelley à l’époque, c’est le vélo du village, tout le monde a une chance de monter dessus… Il y a Rachel aussi, qui allait devenir ma femme, avec son beau visage de pluie. À côté de Shelley, c’est la Lune en face du Soleil… Il y a des gens comme Steve Albarn qui bosse comme portier au Zodiac, la salle de concerts de Cowley Road, et un tas de petits branleurs sympathiques. Une bonne ambiance, un mélange intéressant de gens issus de classes sociales normalement étanches les unes aux autres.
Ian prépare régulièrement, pour quelques convives flattés de cette préférence, de « délicieux cappuccinos ». Le reste des invités, au parfum, rigole : il fait mousser du produit vaisselle dans une tasse à demi pleine de café… Saupoudré de cacao, le résultat est parfaitement appétissant ! On y a tous droit au moins une fois. Il y a cette légèreté-là avec Ian, qui brise d’emblée la glace, la distance que sa beauté, trop frappante, trop grande pour un mec, met entre lui et les autres. Superficiellement, beaucoup de gens trouvent notre musique gaie et les paroles tristes. Mais si on réécoute aujourd’hui nos premiers titres, on comprend qu’il y a une réelle connexion entre la musique et les paroles, avec des tonalités souvent mineures, des dissonances… C’est quelque chose qui apparaît à l’analyse, qui n’était pas évident sur le coup. Par la suite on a été capable de tout chanter, et ce qui fait le lien entre chacun de nos albums, c’est l’énergie, cette énergie incroyable qu’aucun d’entre nous n’est vraiment capable d’expliquer mais qui résultait de notre association, qui allait faire de nos concerts le phénomène que l’on sait, qui plus tard nous dépasserait… Mais j’anticipe. Au début, on ne savait encore rien de tout ça, on en était à essayer des formules. On en était à se chercher un nom…
© Frédéric Le Roux, 2006

 « C’est incroyable les progrès que ton père a fait sur les dernières chansons. Tu as remarqué ? Il a débarrassé sa voix de tout ce qu’elle avait d’arrogant, de clinquant… C’est comme s’il chantait à partir de lui-même, pas à partir de la musique, comme avant… »
« C’est incroyable les progrès que ton père a fait sur les dernières chansons. Tu as remarqué ? Il a débarrassé sa voix de tout ce qu’elle avait d’arrogant, de clinquant… C’est comme s’il chantait à partir de lui-même, pas à partir de la musique, comme avant… »